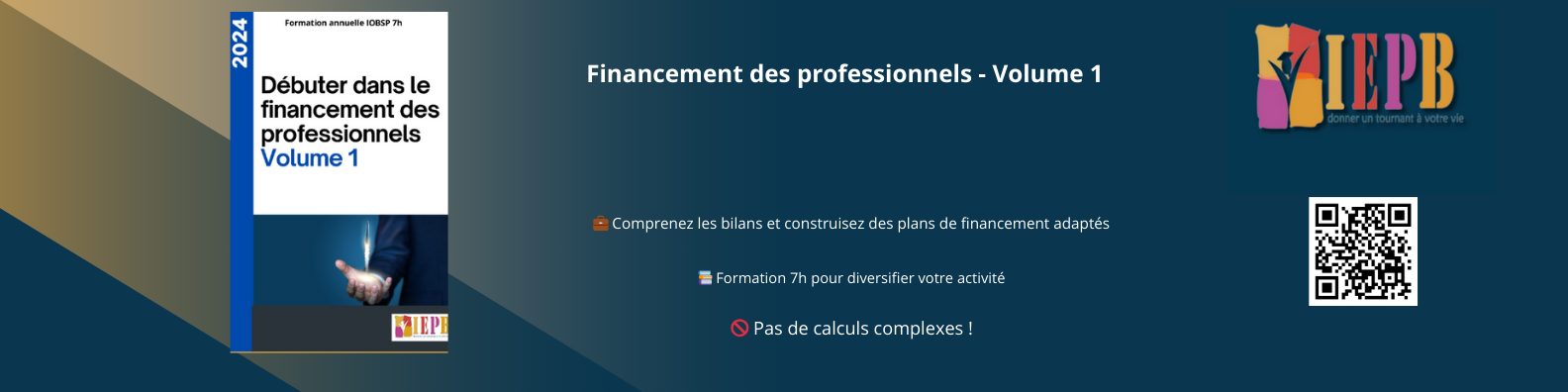Journée internationale du droit des femmes oblige, nous sommes ravis de vous présenter notre analyse sur une directive qui bouscule. L’Union Européenne a de nouveau marqué un grand coup à travers sa directive 2022/2381 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes . En effet, l’égalité étant une valeur fondatrice de l’Union Européenne, celle-ci s’engage sans relâche à l’intégrer parmi ses États membres, notamment en ce qui concerne le monde de l’emploi . De plus , les inégalités Hommes-Femmes dans le monde de l’emploi étant au cœur de sa feuille de route , l’institution européenne ne lésine pas sur les moyens afin de se rapprocher de l’idéal visé. L’article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permet d’ailleurs au Parlement européen et au Conseil “d’adopter des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail.”
La directive 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 constitue une nouvelle avancée majeure dans la législation européenne, imposant aux sociétés cotées un délai précis pour se conformer à ses exigences. En effet, cette directive fixe un quota de femmes au sein des conseils d’administration, avec une échéance fixée au 30 juin 2026. Avant d’examiner en détail cette directive visant à accroître la présence des femmes au sein des conseils d’administration des grandes entreprises, il est essentiel d’en comprendre l’historique et le contexte.
Une directive au parcours semé d’embûches…
L’idée d’imposer un quota de femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises n’est pas nouvelle. Dès 2012, la Commission européenne, sous l’impulsion de Viviane Reding, alors vice-présidente (justice, droits fondamentaux et citoyenneté) propose conjointement avec les autres vices-présidents et commissaires de l’époque, un projet de directive visant à établir un seuil minimum de 40 % de femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse. Cependant, cette proposition se heurte à l’opposition de plusieurs États membres, notamment l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui privilégient des mesures volontaires plutôt qu’une régulation contraignante. Le projet reste ainsi bloqué pendant près d’une décennie. L’arrivée d’Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne en 2019 redonne une impulsion à ce projet. Dans le cadre de la stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025,
1 le vice-président Antonio Tajani (industrie et entrepreunariat), le vice‑président Joaquín Almunia (concurrence), le vice-président Olli Rehn (affaires économiques et monétaires), le commissaire Michel Barnier (marché intérieur et services) et le commissaire László Andor (emploi et affaires sociales)
La Commission remet la question des quotas de genre au centre du débat. La pandémie de COVID-19 met en lumière les inégalités persistantes entre les sexes, notamment en matière d’accès aux postes de décision.
En 2012, les conseils des sociétés (conseil d’administration, de surveillance ou directoire) restent largement dominés par les hommes, qui occupent 85 % des postes d’administrateurs non exécutifs et 91,1 % des postes d’administrateurs exécutifs, contre seulement 15 % et 8,9 % pour les femmes. Malgré un débat public soutenu et diverses initiatives volontaires aux niveaux national et européen, les avancées restent limitées : depuis 2003, la part des femmes dans ces instances n’a progressé en moyenne que de 0,6% par an.
2 communiqué de Bruxelles du 14 Novembre 2012 de la commission européenne.
Ces chiffres préoccupants soulignaient l’urgence d’adopter une directive adéquate pour remédier à ces inégalités flagrantes. Il était crucial de mettre en place une législation sur la parité au sein des grandes entreprises qu’à l’époque, onze pays de l’UE avaient adopté et mis en place des instruments juridiques afin d’améliorer cette situation, surtout lorsqu’on sait que la parité Hommes-Femmes au sein des conseils d’administration des grandes entreprises revêt des avantages économiques et sociaux. En effet, promouvoir une meilleure parité entre les sexes présente des avantages économiques et sociaux significatifs. Économiquement, la diversité de genre dans les conseils d’administration et les équipes de direction améliore la performance des entreprises, favorise l’innovation et permet d’accéder à un réservoir de talents plus large, ce qui augmente la rentabilité. En outre, les entreprises qui promeuvent l’égalité créent un environnement de travail inclusif, entraînant une plus grande satisfaction des employés et une réduction du turnover. Sur le plan social, l’égalité des sexes est une question de justice sociale, garantissant des opportunités équitables pour tous. Elle offre également des modèles de rôle inspirants
3 Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Danemark, Finlande, Grèce, Autriche et Slovénie
4 Le turnover ou taux de rotation du personnel, désigne le renouvellement des effectifs au sein d’une entreprise sur une période donnée. Il est calculé en fonction du nombre de départs et d’arrivées de salariés et peut être un indicateur de la stabilité de l’emploi dans une organisation. Un turnover élevé peut refléter des problèmes tels qu’un manque de satisfaction au travail, de mauvaises conditions ou une mauvaise gestion, tandis qu’un turnover faible peut indiquer une bonne rétention des talents et un environnement de travail stable.
pour les jeunes filles, aide à briser les stéréotypes de genre, et encourage des politiques favorisant l’équilibre travail-vie personnelle. En fin de compte, une société qui valorise la parité renforce la cohésion sociale et contribue à un sentiment d’appartenance pour tous ses membres, démontrant que l’engagement en faveur de l’égalité est bénéfique pour l’ensemble de la société.
Objectif de la directive
La directive actuelle a pour objectif d’atteindre une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des sociétés cotées, en mettant en place des mesures efficaces pour accélérer les progrès vers l’égalité entre les sexes, tout en permettant aux entreprises cotées de disposer de suffisamment de temps pour effectuer les ajustements nécessaires. Étant à 1 an et 4 mois de la date limite pour la transposition de la directive dans la législation interne de chaque pays membres et donc l’application de son contenu par les sociétés concernées.
Champs d’application
La présente directive s’applique aux sociétés cotées
5 article 1 de la directive, 6 article 2 de la directive
, ce qui revient à dire que les PME et micro-entreprise sont exclues. Article 3 Définitions on entend par: 1) «société cotée», une société ayant son siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE, dans un ou plusieurs États membres;
Les principaux points
Les États membres doivent veiller à ce que les sociétés cotées atteignent un des objectifs fixés d’ici le 30 juin 2026. Cela signifie que les membres du sexe sous-représenté doivent occuper au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou représenter au moins 33 % de l’ensemble des postes d’administrateurs, qu’ils soient exécutifs ou non. Pour les sociétés qui ne sont pas soumises à cet objectif, elles doivent établir des objectifs quantitatifs individuels pour améliorer l’équilibre entre les sexes parmi les administrateurs exécutifs et s’efforcer de les atteindre d’ici la même date. De plus, le nombre de postes d’administrateurs non exécutifs nécessaires pour atteindre l’objectif de 40 % doit être le plus proche possible de cette proportion, sans dépasser 49 %. Par ailleurs, cette directive expire le 31 Décembre 2038.
7 article 5 de la directive
Les moyens mis en oeuvre
Les États membres doivent s’assurer que les sociétés cotées qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 1, adaptent leur processus de sélection des candidats pour les nominations ou élections aux postes d’administrateurs. Cette sélection doit reposer sur une évaluation comparative des qualifications de chaque candidat, en utilisant des critères clairs, neutres et non discriminatoires tout au long du processus, y compris lors de la rédaction des annonces de vacance et de la création des listes restreintes. De plus, lorsque plusieurs candidats possèdent des qualifications égales, la priorité doit être accordée au candidat du sexe sous-représenté, sauf dans des cas exceptionnels où des raisons juridiques prépondérantes justifient la sélection d’un candidat de l’autre sexe. Les États membres doivent également veiller à ce que, si un candidat non retenu le demande, les sociétés cotées lui fournissent des informations sur les critères de sélection, l’évaluation comparative des candidats et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles un candidat de l’autre sexe a été préféré. En cas de contestation par un candidat non retenu, il incombe à la société cotée de prouver qu’il n’y a pas eu de violation des dispositions en matière de sélection, tout en respectant le droit des États membres d’adopter des règles de preuve plus favorables aux plaignants. Enfin, lorsque le processus de sélection se fait par vote des actionnaires ou des travailleurs, les États membres doivent s’assurer que les votants sont correctement informés des dispositions de la directive et des sanctions encourues en cas de non-respect. De plus , les sociétés cotées ont l’obligation de fournir une fois par an aux autorités compétentes, le compte rendu de l’état de représentation des femmes dans leur conseil d’administration.
Trois ans après…
Près de 3 ans depuis la sortie de la directive, quel bilan? Sur les 27 Etats de l’Union Européenne, seuls 9 ont déjà introduit un système de quota afin de favoriser la présence des femmes dans les conseils d’administrations des sociétés cotées. Il s’agit de la France, l’Italie, l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche et la Grèce. La France apparaît en tête avec 46,3% , ce qui est à féliciter. Cependant , les autres pays comme l’Estonie avec 8,3% ou encore Chypre avec 9,8%, présentent des chiffres assez faibles, ce qui peut amener à se questionner sur la faisabilité de la transposition de cette directive. Serait-ce plus “ facile” pour les uns et moins pour d’autres pays cependant l’impact n’est pas le même comme le démontre le graphique ci-contre datant de 2023. Serait-ce irréalisable ou c’est une affaire de temps? Est-ce le nombre de la gente féminine qui pose problème? A l’aube de la date limite pour la transposition de cette directive, il convient de sincèrement se pencher sur la question.
8 article 7 de la directive
Les sanctions
Les États membres sont chargés de définir les sanctions applicables aux sociétés cotées en cas de non-respect des obligations prévues par la directive, notamment en matière de sélection des administrateurs et d’égalité de genre. Ils doivent mettre en place des procédures administratives ou judiciaires efficaces pour garantir l’application de ces sanctions, qui doivent être proportionnées, dissuasives et adaptées à la gravité des infractions. Ces sanctions peuvent inclure des amendes ou l’annulation de décisions prises en violation des règles établies. Par ailleurs, les sociétés cotées ne peuvent être tenues responsables que des omissions ou actes qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imputables conformément à leur droit national .
Enfin, les États membres s’assurent que les sociétés cotées respectent les obligations en matière de droit social et de droit du travail lors de l’exécution des marchés publics et des concessions, en conformité avec le droit de l’Union en vigueur.
Les Obstacles
La directive sur l’équilibre entre les sexes dans les conseils d’administration des sociétés cotées fait face à plusieurs difficultés et critiques. Certains estiment qu’elle remet en cause le principe du mérite, en favorisant des recrutements basés sur le genre plutôt que sur les compétences. Elle impose également des contraintes aux entreprises, qui pourraient rencontrer des difficultés à identifier suffisamment de candidates qualifiées, notamment dans les secteurs où les femmes sont sous-représentées. De plus, cette mesure est perçue par certains comme une ingérence dans la gouvernance des entreprises, limitant leur liberté dans le choix de leurs administrateurs. L’applicabilité et les sanctions posent aussi problème, car la mise en œuvre peut varier selon les États membres en raison de différences culturelles, économiques et juridiques, ce qui pourrait ralentir ou affaiblir son application. Enfin, l’impact à long terme de cette directive sur la gouvernance et la compétitivité des entreprises reste incertain, bien que des études montrent que la diversité améliore la performance des entreprises. Ainsi, malgré ses ambitions en faveur de l’égalité des sexes, cette directive soulève des défis liés à son acceptation, son application et ses effets concrets. Cependant, nous restons optimistes quant à son applicabilité complète car ne l’oublions pas, celle-ci a été adoptée après dix années.
Conclusion
La directive visant à renforcer l’équilibre entre les sexes dans les conseils d’administration des sociétés cotées constitue une avancée significative en matière d’égalité professionnelle en Europe. En imposant des quotas et des mesures concrètes, elle vise à accélérer la représentation des femmes aux postes de décision. Toutefois, sa mise en œuvre soulève des défis majeurs, notamment en termes d’acceptation, de faisabilité pour les entreprises et d’harmonisation entre les États membres. Si son efficacité à long terme reste à évaluer, cette directive envoie néanmoins un signal fort en faveur de la diversité et de la modernisation de la gouvernance des entreprises européennes.
Marlène OBIANG
Juriste stagiaire à l’IEPB
Les Quotas imposés