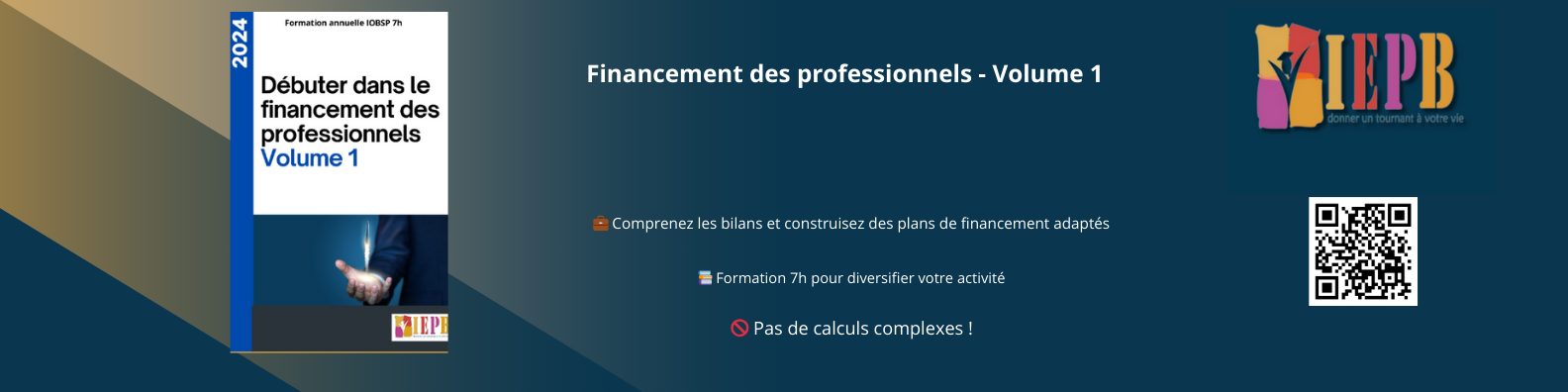Un métier, deux philosophies
Le courtage en crédit connaît une évolution rapide, tiraillée entre deux modèles. D’un côté, le mandat de recherche de capitaux — reconnu juridiquement depuis 2013 — permet à un courtier d’exercer sans convention avec les banques.De l’autre, certains professionnels comme Julien MAISONNET, sous licence Négocial, militent pour un ancrage
fort du courtier dans la sphère bancaire, à travers des conventions formelles. Entre ces deux postures, c’est la question de l’indépendance, de la rémunération, de la qualité du service et de la reconnaissance du métier qui se joue.
Le mandat de recherche de capitaux : fondement juridique du métier
Le mandat de recherche de capitaux a été officialisé en 2013, conférant une assise juridique claire au courtier en crédit immobilier. Ce mandat est encadré par le Code monétaire et financier (CMF), notamment les articles L.519-1 à L.519-6 pour les IOBSP (intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement), et par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 sur la régulation bancaire.
L’article L.519-1 du CMF définit le courtier comme un intermédiaire exerçant à titre habituel une activité consistant à présenter, proposer ou aider à la conclusion d’une opération de crédit. Le mandat constitue donc l’instrument principal légitimant son intervention.
Ce mandat permet à un courtier, même sans convention avec une banque, de présenter un dossier de crédit pour un client. L’objectif ? Préserver l’indépendance du conseil, la neutralité dans le choix des partenaires et la liberté d’action vis-à-vis des établissements bancaires.
La doctrine des conventions : un modèle plus intégré
Julien MAISONNET défend quant à lui un autre modèle : celui d’un courtier conventionné avec les banques. Dans cette approche, le courtier est sélectionné par les établissements bancaires, dispose d’un accès direct à leurs produits et est rémunéré, souvent à hauteur de 1% du montant du prêt apporté.
Cette logique vise à garantir :
- une relation de confiance réciproque entre banque et courtier,
- une fluidité d’instruction des dossiers,
- et un meilleur taux de transformation en raison de l’alignement des outils et des process.
Mais ce système n’est pas sans dérives : il peut induire un biais commercial chez le courtier, poussé à privilégier la banque la plus rémunératrice, au détriment de l’intérêt du client — ce que dénonce vivement Bérengère DUBUS, secrétaire générale de l’UIC (Union des Intermédiaires de Crédit).
Une jurisprudence défavorable aux courtiers non conventionnés
La tension entre ces deux modèles a trouvé une résonance judiciaire dans une jurisprudence récente, qui a déçu de nombreux courtiers. La décision rappelle que rien n’oblige une banque à instruire une demande de crédit présentée par un courtier non référencé, même s’il agit en vertu d’un mandat régulier et conforme.
Cette jurisprudence a confirmé l’effet relatif du contrat, principe fondamental du droit des obligations (article 1200 du Code civil) : un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties qui l’ont signé. En d’autres termes, une banque n’est pas tenue de considérer le mandat donné par un client à un courtier si elle n’a pas accepté contractuellement de traiter avec ce courtier.
Conséquence : certains établissements refusent catégoriquement les dossiers émanant de courtiers non conventionnés, bloquant ainsi leur activité malgré la validité juridique de leur mandat.
Le débat éthique : intérêt du client ou survie du modèle ?
Cette opposition révèle une fracture dans la vision du métier. Pour Bérengère DUBUS, le mandat garantit la liberté du courtier et protège l’intérêt du client contre les logiques commerciales des banques. Elle accuse Julien MAISONNET de vouloir réserver l’activité à une élite de courtiers conventionnés, remettant en cause l’égalité d’accès au marché et la diversité de l’offre.
À l’inverse, Julien MAISONNET revendique une logique de qualité : seules les structures rigoureuses, bien organisées et sérieuses devraient pouvoir obtenir des conventions. Il dénonce une forme d’opportunisme chez ceux qui veulent contourner la sélection bancaire.
Le cadre légal et les obligations des parties
La réglementation actuelle impose déjà un encadrement strict du courtage :
- devoir de conseil,
- obligation d’information,
- vérification de la solvabilité du client,
- transparence des rémunérations.
Le mandat écrit est obligatoire et doit être accepté avant toute prestation. L’arrêté du 1er mars 2012, modifié par celui du 26 juin 2020, impose également une information précontractuelle renforcée sur les relations entre le courtier et les banques.
Mais aucune règle n’oblige une banque à accepter de travailler avec tous les courtiers. Le principe de liberté contractuelle reste maître : une banque choisit ses partenaires. D’où la nécessité, pour les courtiers, de négocier des conventions, ou de trouver d’autres voies (comme les plateformes de regroupement ou le portage).
Les conséquences concrètes pour la profession
Ce clivage impacte :
- les jeunes courtiers : difficile pour eux d’obtenir des conventions rapidement.
- la lisibilité du métier : les clients ne comprennent pas toujours pourquoi leur courtier ne peut pas déposer un dossier dans toutes les banques.
- la rémunération : les courtiers non conventionnés doivent souvent se faire rémunérer par le client, ce qui peut être un frein.
De plus, la jurisprudence actuelle pousse à une forme de professionnalisation forcée : pour survivre, le courtier doit soit obtenir des conventions (et donc avoir un certain volume, une rigueur opérationnelle, un CRM performant…), soit s’adosser à un réseau plus structuré.
Vers une solution d’équilibre ?
Faut-il opposer les deux modèles ? Peut-être pas. Certains acteurs militent pour une reconnaissance duale : le mandat pour garantir l’indépendance, les conventions pour fluidifier les relations. Des plateformes techniques pourraient jouer un rôle d’intermédiation, en permettant à des courtiers non conventionnés de déposer des dossiers via un réseau.
À long terme, la régulation européenne pourrait trancher, notamment à travers le paquet FIDA, qui cherche à harmoniser les pratiques d’intermédiation dans le secteur financier.
FIDA : un tournant décisif et un appel à la mobilisation
La réforme européenne portée par le règlement FIDA (Financial Intermediation and Distribution Act) représente un enjeu majeur pour le futur du courtage en crédit. Derrière les intentions d’harmonisation et de transparence, se cache un risque réel de renforcement des exigences administratives et techniques qui pourrait défavoriser les courtiers indépendants au profit des des grandes enseignes intégrées.
Ces dernières, souvent bien structurées et puissamment représentées par leurs lobbies à Bruxelles, cherchent à verrouiller l’accès au marché via des obligations de conformité inadaptées aux plus petites structures. L’objectif non déclaré ? Réduire la concurrence directe des courtiers autonomes en les obligeant soit à rejoindre un grand réseau en tant que mandataires, soit à disparaître.
Pourtant, sur le terrain, les clients ne s’y trompent pas. Nombreux sont ceux qui ont obtenu un financement mieux adapté, plus rapide, voire plus avantageux en passant par un courtier indépendant local, bien implanté et réellement à l’écoute, plutôt qu’en s’adressant à une enseigne nationale.
C’est ici que le combat se précise : l’intérêt de l’emprunteur face à l’intérêt des banques. Car derrière le maillage des conventions bancaires se cache aussi la logique économique des établissements prêteurs, qui vise à maximiser leur marge, pas nécessairement à optimiser les conditions pour les clients.
À ce titre, la communauté des courtiers doit se mobiliser. Selon leur vision — modèle du mandat ou modèle de la convention —, les professionnels doivent s’exprimer activement dans les consultations publiques, via leurs syndicats ou de manière directe, pour éviter que l’avenir du courtage ne soit écrit uniquement par les grands groupes.
Conclusion : deux visions, une même mission
Le débat entre mandat et conventions révèle les fractures d’un métier en transition. Mais il serait dommage qu’il dégénère en guerre de chapelles. Le véritable enjeu reste l’intérêt du client, la qualité du conseil, et la reconnaissance du métier.
Dans un contexte où les banques réduisent leurs partenaires et où la pression réglementaire augmente, il est urgent que la profession trouve un modèle équilibré, garantissant à la fois liberté, rigueur et transparence.
Par Jérôme CUSANNO
Directeur de l’IEPB