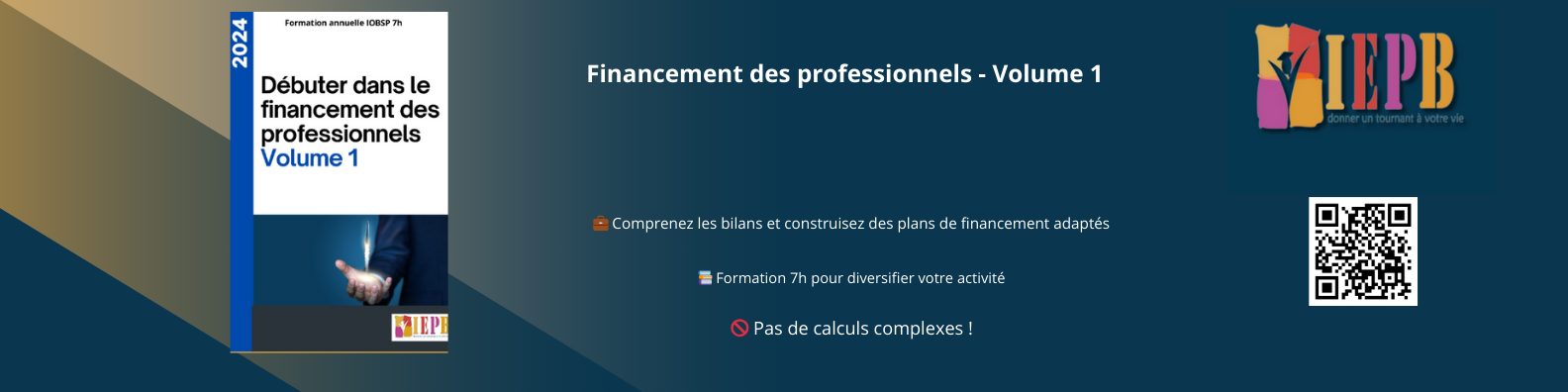Depuis l’entrée en vigueur de la réforme du courtage le 1er avril 2022, le paysage français du courtage en assurance et en crédit a connu une transformation significative. Cette réforme, initiée par la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, a instauré l’obligation pour les courtiers et leurs mandataires d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avant de pouvoir s’immatriculer à l’ORIAS, le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.
Un dispositif de co-régulation renforcé
L’objectif principal de cette réforme est de renforcer la supervision des intermédiaires en assurance et en crédit, secteurs historiquement difficiles à contrôler en raison de leur hétérogénéité. Les associations professionnelles agréées se voient alors confier des missions précises, notamment :
- Vérifier la mise en place d’un service de médiation pour les clients.
- Contrôler les capacités professionnelles des dirigeants et du personnel.
- S’assurer du respect des obligations de formation continue.
- Vérifier la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, d’une garantie financière.
- Contrôler les documents d’immatriculation, notamment l’extrait Kbis et l’objet social.
Ces missions visent à garantir la compétence et la probité des professionnels du secteur, tout en assurant une meilleure protection des consommateurs. Dont acte.
Des critères de représentativité stricts
Pour obtenir et conserver leur agrément, les associations professionnelles doivent répondre à des critères de représentativité définis par l’ACPR. Ainsi, une association agréée pour un seul domaine (assurance ou crédit) doit représenter au moins 10 % des professionnels assujettis immatriculés à l’ORIAS dans ce domaine. Si l’association est agréée pour les deux domaines, ce seuil est abaissé à 5 % pour chacun.
Le non-respect de ces seuils peut entraîner le retrait de l’agrément, comme cela a été le cas pour l’AFIB et La Compagnie IAS en mars 2025. Ces deux associations n’ayant pas atteint les seuils requis, l’ACPR a décidé de leur retirer leur agrément, avec effet au 11 juillet 2025 pour La Compagnie IAS et au 12 juillet 2025 pour l’AFIB. Les membres de ces associations disposent d’un délai de trois mois pour adhérer à une autre association agréée.
Des critiques sur la méthode et les conséquences
La décision de l’ACPR de retirer l’agrément de ces deux associations a suscité des critiques, notamment en raison de son timing en cours d’année. Certains professionnels estiment qu’une telle décision aurait dû être alignée sur le calendrier civil, avec une prise d’effet au 1er janvier, afin de faciliter la transition pour les adhérents.
De plus, la méthode de calcul de la représentativité est remise en question. En effet, l’ORIAS ne fournit pas de chiffres précis sur le nombre de mandataires d’intermédiaires et de mandataires d’assurance, ce qui complique l’évaluation exacte de la représentativité des associations. Certains professionnels non assujettis par la loi adhèrent volontairement à une association, faussant ainsi les chiffres.
Enfin, il s’agit d’une décision administrative, heureusement, susceptible de recours. Si le recours est fructueux, que feront les professionnels qui auront déjà opté pour une autre association ou qui auront été conduits vers une autre association ?
Des risques de conflits d’intérêts
La réforme a également mis en lumière des risques potentiels de conflits d’intérêts au sein des associations professionnelles. Certaines associations ont été accusées de favoriser des partenaires commerciaux, notamment dans le domaine de la formation, sans recourir à des appels d’offres publics. Par exemple, des dirigeants d’associations possèdent des organismes de formation et incitent fortement leurs adhérents à y suivre leurs formations obligatoires.
L’ACPR, bien qu’elle impose aux associations de mettre en place des dispositifs de prévention des conflits d’intérêts, se déclare incompétente pour juger de tels conflits, laissant cette responsabilité aux tribunaux.
Une concentration du pouvoir préoccupante
Le retrait de l’agrément de certaines associations réduit le nombre d’associations agréées, limitant ainsi le choix pour les professionnels. Cette concentration du pouvoir dans un nombre restreint d’associations peut poser des problèmes de concurrence et de favoritisme. Il existe un risque que ces associations exercent une influence excessive sur le marché, en orientant les professionnels vers certains partenaires ou en imposant des conditions d’adhésion restrictives.
Vers une reconsidération du cadre réglementaire ?
Face à ces critiques, certains professionnels appellent à une reconsidération du cadre réglementaire. Ils suggèrent notamment :
- Une révision des critères de représentativité, en tenant compte de la réalité du terrain.
- Une plus grande transparence dans les partenariats commerciaux des associations.
- Une clarification des compétences de l’ACPR en matière de conflits d’intérêts.
- Une évaluation régulière de l’impact de la réforme sur la concurrence et la diversité du marché.
La réforme du courtage, bien qu’animée par une volonté de renforcer la régulation et la protection des consommateurs, soulève des questions légitimes sur sa mise en œuvre et ses conséquences. Il est essentiel que les autorités compétentes restent à l’écoute des professionnels et adaptent le cadre réglementaire en fonction des retours du terrain. Mais pour le moment, on reste dans l’entre-soi.
Le risque d’une dérive vers une autorisation d’exercice
Au-delà des critiques techniques et conjoncturelles, une inquiétude plus profonde commence à émerger chez certains observateurs du secteur : celle d’un glissement progressif vers un système d’autorisation d’exercer, accordée non plus par une autorité administrative indépendante, mais par des structures privées, en l’occurrence les associations professionnelles agréées. Si l’adhésion à une association est désormais obligatoire pour exercer, et si ces associations peuvent perdre leur agrément en cours d’année, ne risquent-elles pas, à terme, de devenir des juges et parties dans le monde du courtage ?
C’est cette logique de co-régulation poussée à l’extrême qui interroge. Le rôle d’une association professionnelle n’est-il pas avant tout d’accompagner ses membres, de les représenter, et non de contrôler ou de sanctionner ? En conférant à ces structures des missions quasi-réglementaires, l’ACPR prend le risque de brouiller les rôles et de diluer sa propre autorité.
Gouvernance : un maillon faible ?
Autre sujet sensible : la gouvernance interne des associations. Qui siège dans les conseils d’administration ? Ces instances décisionnaires sont-elles représentatives de la diversité des acteurs du secteur, notamment des petites entreprises ? Si une association est gouvernée exclusivement par de grands cabinets ou des groupes de courtage puissants, quel regard porte-t-elle sur les problématiques spécifiques des TPE, des indépendants ou des structures régionales ?
L’absence de pluralité dans la gouvernance pourrait entraîner une uniformisation des décisions et des positions, au détriment de l’agilité du secteur et de sa capacité à s’adapter aux réalités de terrain. Certains redoutent même que cela ne favorise une forme d’élitisme ou de verrouillage de la profession.
Des partenariats commerciaux sous surveillance
Le développement de partenariats commerciaux par les associations – avec des compagnies d’assurance, des prestataires informatiques, ou encore des organismes de formation – pose de réels enjeux de transparence. D’autant plus que les associations bénéficient d’une base d’adhérents captifs, imposée par la loi. Ces accords donnent lieu, dans certains cas, à des rétrocommissions qui soulèvent des questions éthiques.
Peut-on accepter qu’un organisme doté d’une mission d’intérêt général fonctionne selon une logique de revenus commerciaux, sans appel d’offres ni cadre réglementaire strict ? À l’heure où la transparence est un impératif dans tous les domaines, l’opacité des relations d’affaires des associations agréées devient un angle mort préoccupant dont tout le monde se moque apparemment.
Des précédents existent : dans le domaine du conseil en investissement financier, l’ANACOFI avait été mise en cause en raison de soupçons de conflit d’intérêts liés à un centre de formation dirigé par l’épouse d’un dirigeant de l’association. Ce type de pratique alimente la méfiance et fragilise la légitimité du dispositif dans son ensemble.
Ne nous y trompons pas ! Une des associations professionnelles qui annonce son déménagement sur les réseaux sociaux parlent de “clients”. Les intermédiaires sont donc des clients et plus des adhérents. Que diriez-vous si vous étiez obligés de faire vos courses chez Leclerc, Carrefour ou Auchan au mépris des autres enseignes ou de vos goûts ? Lapsus ou réalité ?
L’ACPR dans un rôle ambigu
L’ACPR, qui est censée veiller à la stabilité du système financier et à la protection des clients, se trouve dans une position délicate. D’un côté, elle confie de plus en plus de missions aux associations, exigeant des moyens humains, financiers et techniques importants. De l’autre, elle refuse de se prononcer sur les conflits d’intérêts ou les orientations stratégiques prises par ces structures, au nom de leur statut privé.
Cette délégation sans contrôle approfondi est une ligne de crête dangereuse. Car si une association abuse de sa position, vers qui les adhérents peuvent-ils se tourner ? Les recours juridiques existent, mais ils sont longs, coûteux, et peu accessibles aux petites structures.
Vers un nécessaire rééquilibrage ?
Face à ces constats, plusieurs propositions émergent parmi les professionnels du secteur :
- Clarifier le périmètre des missions confiées aux associations agréées, en réaffirmant le rôle prépondérant de l’ACPR dans le contrôle et la régulation.
- Encadrer les partenariats commerciaux des associations, avec une obligation de transparence et, pourquoi pas, une déclaration publique des conventions signées.
- Instaurer des règles de gouvernance internes, imposant une représentativité équilibrée des membres, en tenant compte des tailles d’entreprise, des zones géographiques, et des métiers exercés.
- Améliorer le processus d’évaluation de la représentativité, en exigeant de l’ORIAS une meilleure granularité des données sur les catégories d’intermédiaires.
- Fixer un calendrier prévisible pour les retraits d’agrément, de manière à sécuriser les parcours d’adhésion et d’immatriculation.
Une réforme perfectible mais essentielle
Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe même de la réforme. Nombreux sont les professionnels qui reconnaissent qu’elle a permis de structurer un secteur longtemps perçu comme éclaté, voire opaque. Elle a aussi mis en avant la responsabilité collective des acteurs du courtage vis-à-vis de leurs pratiques.
Mais comme toute réforme ambitieuse, celle-ci doit faire l’objet d’un suivi, d’une évaluation continue et d’éventuels ajustements. Faute de quoi, elle risque de perdre l’adhésion des premiers concernés, c’est-à-dire les courtiers eux-mêmes.
La régulation est un équilibre subtil entre autorité et confiance, entre normes collectives et respect des libertés individuelles. Il est encore temps de retrouver cet équilibre.
Jérôme CUSANNO
Directeur de l’iepb