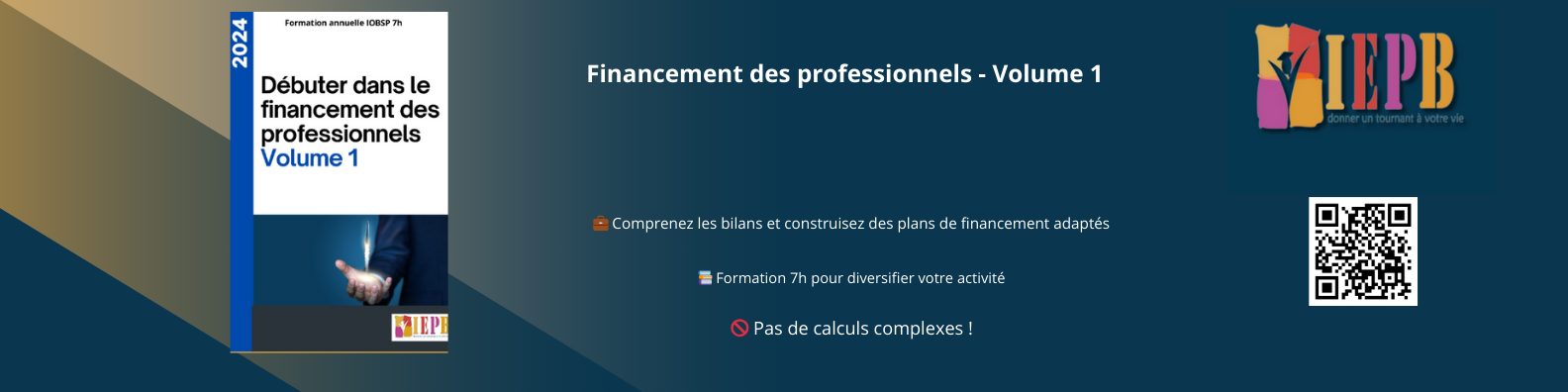La finance durable est devenue un mot d’ordre incontournable. Qu’il s’agisse des fonds d’investissement, des grandes banques, des assureurs ou des pouvoirs publics, tout le monde se revendique désormais de cette bannière verte. Les discours sont emplis de références à la transition énergétique, aux critères ESG, aux obligations vertes ou à la taxonomie européenne. Impossible d’ouvrir un rapport annuel d’une banque sans y trouver des pages entières consacrées à la lutte contre le réchauffement climatique.
Pourtant, derrière ce vocabulaire en apparence rassurant, se cache une réalité bien plus nuancée. La finance durable existe, oui. Mais dans bien des cas, elle reste davantage un outil de communication qu’un véritable levier de transformation.
La promesse séduisante d’une finance au service de la planète
L’idée est simple, presque évidente : puisque la finance irrigue l’économie, il suffirait d’orienter les flux financiers vers des activités vertueuses pour accélérer la transition écologique. En pratique, cela prend la forme d’obligations vertes, de fonds ISR, de prêts bonifiés à des entreprises qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L’Union européenne elle-même s’est engagée dans ce mouvement en élaborant une taxonomie verte, censée définir de manière claire ce qui peut être considéré comme durable. Sur le papier, tout est donc en place pour une révolution silencieuse, où le capital deviendrait un acteur clé de la lutte contre le réchauffement climatique.
Mais la finance a ceci de particulier qu’elle adore les concepts porteurs… tant qu’ils ne contrarient pas trop ses intérêts. Or, il suffit de gratter un peu pour constater que l’enthousiasme affiché masque de nombreuses contradictions.
L’effet vitrine et la tentation du greenwashing
Première critique : la finance durable s’apparente souvent à une vitrine. Les banques mettent en avant leurs engagements climatiques, mais continuent de financer massivement des projets liés aux énergies fossiles. Les fonds estampillés “ESG” contiennent parfois une proportion significative d’entreprises du pétrole, de l’aéronautique ou de l’automobile, justifiées par des critères de gouvernance ou des efforts de transition.
C’est là que surgit le spectre du greenwashing. En jouant sur des définitions floues, en privilégiant des critères non contraignants, les acteurs financiers peuvent se donner une image verte sans modifier en profondeur leurs pratiques. Selon l’ESMA, le régulateur européen des marchés financiers, les controverses liées à l’écoblanchiment dans le secteur ont connu une nette hausse entre 2023 et 2024. Mais ce constat, loin d’effrayer, est souvent intégré comme un risque parmi d’autres, au même titre qu’une variation de taux d’intérêt.
Les retraits de l’Alliance bancaire pour le climat : un signal révélateur
Le récent article des Échos sur les banques européennes s’interrogeant à leur tour sur leur présence au sein de l’Alliance bancaire pour le climat illustre bien cette ambivalence. Créée pour fédérer les grandes institutions financières autour d’engagements concrets de neutralité carbone, cette alliance a perdu plusieurs membres de premier plan, notamment aux États-Unis. Les Européens commencent désormais à douter, avançant les mêmes arguments : contraintes de reporting jugées excessives, risque de contentieux, pression politique accrue.
Ce retrait progressif démontre que lorsque les engagements climatiques cessent d’être de simples déclarations pour devenir des obligations vérifiables, l’enthousiasme se fait plus discret. La finance durable séduit tant qu’elle permet d’améliorer l’image. Elle inquiète dès qu’elle menace les marges.
Des règles encore trop souples
Il faut aussi constater que la réglementation peine à suivre. Certes, l’Union européenne a franchi une étape en 2024 en adoptant des labels plus stricts pour les fonds afin de limiter les abus. Mais l’absence de standardisation mondiale laisse un champ libre à l’arbitrage réglementaire. Les critères diffèrent entre les États-Unis, l’Europe et l’Asie. Une entreprise peut être considérée comme durable selon un label, mais pas selon un autre.
Cette hétérogénéité affaiblit l’ensemble du dispositif et nourrit la méfiance des investisseurs comme des épargnants. Au final, ceux qui paient le prix de ce flou sont souvent les particuliers : croyant investir dans un produit “vert”, ils participent malgré eux au financement d’activités peu vertueuses.
Le rôle de la communication
Le paradoxe, c’est que la finance durable a surtout excellé en communication. Elle a permis aux institutions financières de redorer leur image, souvent ternie par les crises successives. Après la crise de 2008, puis la pandémie, puis l’inflation, le secteur avait besoin d’un récit positif. Quoi de mieux que de se présenter comme un allié de la planète et des générations futures ?
On ne saurait nier l’utilité de ce discours, car il a contribué à placer les enjeux climatiques au centre de la réflexion économique. Mais il devient problématique lorsque la communication prend le pas sur l’action.
Ce qu’il faudrait pour passer de l’affichage à la réalité
Pour que la finance durable mérite vraiment son nom, plusieurs conditions doivent être réunies.
D’abord, des critères clairs et contraignants, permettant de distinguer sans ambiguïté un financement durable d’un financement classique. Ensuite, une traçabilité stricte des fonds, avec des rapports accessibles et vérifiés par des tiers indépendants. Enfin, de véritables sanctions en cas de manquement, afin que l’écoblanchiment ne soit plus seulement un risque réputationnel mais un risque juridique et financier.
Plus fondamentalement, il faut que les banques et assureurs intègrent réellement le risque climatique dans leur évaluation économique. Une sécheresse, une inondation, un durcissement réglementaire : tout cela a des conséquences financières majeures. En ce sens, la finance durable devrait cesser d’être perçue comme une option marketing pour devenir une simple nécessité de bonne gestion du risque.
Et pour les IOBSP ?
Pourquoi ce sujet concerne-t-il directement les intermédiaires en crédit et en assurance ? Parce que les clients, de plus en plus sensibilisés, poseront la question. Quelle banque finance encore le charbon ? Quelle assurance investit dans les énergies fossiles ? À terme, les régulateurs pourraient aussi exiger que les conseils délivrés aux emprunteurs intègrent une dimension durable, ne serait-ce que pour informer sur les produits labellisés. Ou vous pouvez créer une nouvelle catégorie d’emprunt pour les clients intéressés : “le prêt vert”, ou “l’emprunt éco-labellisé”, ou autres “financements issus de fonds ESG”.
Finalement, la finance durable, même si elle reste encore imparfaite, finira par s’imposer dans le quotidien des courtiers. Mieux vaut s’y préparer, non pour céder à un effet de mode, mais pour comprendre les véritables dynamiques à l’œuvre.
La finance durable est à la fois un progrès et une illusion. Elle a permis de mettre sur la table la question de l’orientation des capitaux vers la transition écologique. Mais elle reste affaiblie par ses incohérences, ses dérives marketing et son manque de rigueur. Tant qu’elle ne se traduira pas par des choix mesurables, contraignants et audités, elle restera un mot-clé commode, plus qu’une véritable révolution.
Pour les professionnels du crédit et de l’assurance, le défi est clair : ne pas se laisser aveugler par les slogans, mais analyser avec lucidité les opportunités et les limites de cette finance en devenir. Car si la planète ne peut pas se contenter de promesses, vos clients non plus.
Jérôme CUSANNO
Directeur de l’iepb.