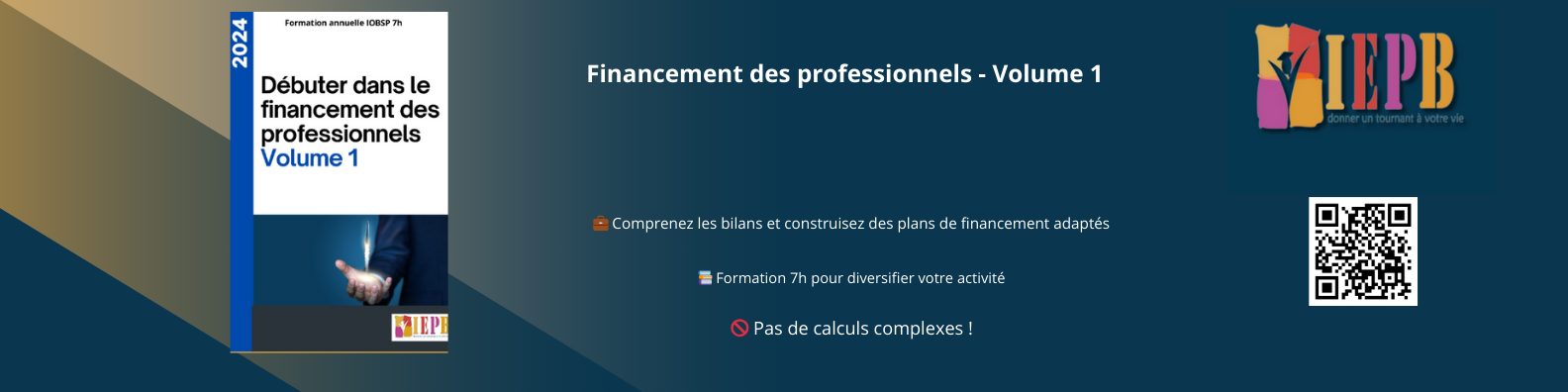Dans plusieurs pays européens comme la Belgique ou encore au Maroc, un outil de régulation du crédit appelé fichier positif est en place. Ce registre centralisé répertorie tous les crédits en cours contractés par un individu, permettant aux banques et autres organismes prêteurs de consulter la situation d’endettement avant d’accorder un nouveau prêt. En France, ce mécanisme n’existe pas. Le pays fonctionne avec un fichier négatif, le Fichier des Incidents de Paiement de Crédits aux Particuliers (FICP), qui ne recense que les emprunteurs ayant eu des incidents de paiement ou ayant déclaré un surendettement. Cette absence soulève des questions quant à la gestion du surendettement, la prévention crédits à la consommation ou encore de crédits renouvelables.
Ce dispositif a plusieurs avantages. Il permet, par exemple, de détecter rapidement les emprunteurs proches du surendettement et d’éviter qu’ils ne multiplient les emprunts sans capacité de remboursement. Au Maroc, un système similaire permet également de sécuriser les banques face au risque d’insolvabilité, tout en responsabilisant les emprunteurs.
En France, cependant, un tel fichier est absent. Le FICP, géré par la Banque de France, fonctionne en mode “curatif” : il n’intervient qu’en cas de défaut de paiement. Ce fichier est consultable par les banques avant tout octroi de crédit, mais il offre une vue limitée, sans indiquer les engagements financiers en cours d’un individu. Cela prive les prêteurs d’une vision globale de la situation financière de leurs clients.
Surendettement : le débat du fichier positif
Avec environ 1,1 million de ménages surendettés recensés chaque année en France (selon la Banque de France), la question de la prévention du surendettement est cruciale. Les défenseurs du fichier positif estiment qu’il permettrait de lutter efficacement contre ce fléau en limitant l’octroi de crédits aux emprunteurs déjà fragiles.
L’idée a été évoquée à plusieurs reprises dans l’Hexagone, notamment en 2013 lors des débats sur la loi Hamon relative à la consommation. À l’époque, les détracteurs ont souligné plusieurs écueils possibles :
Impacts sur les opérations de regroupement et de rachat de crédits.
L’introduction d’un fichier positif en France bouleverserait également les pratiques autour des opérations de regroupement de crédits (destinées aux ménages surendettés) et des rachats de crédits immobiliers ou professionnels.
Regroupement de crédits : prévention et complexité.
Actuellement, les IOBSP (intermédiaires en opérations de banque et services de paiement) jouent un rôle crucial dans ces opérations. Un fichier positif faciliterait leur travail en offrant une vision claire de la situation d’endettement des clients. Cela permettrait de proposer des solutions mieux adaptées et d’éviter des regroupements réalisés uniquement en urgence après un surendettement manifeste.
Cependant, un tel outil pourrait aussi compliquer l’accès au regroupement. En effet, si le système limite l’endettement et le surendettement, alors il y aura moins de candidats au regroupement de crédits. Il ne resterait que les opérations de regroupement consistant à dégager de nouveau une capacité d’emprunt pour réaliser un nouvel achat ou un projet.
Rachat de crédits : plus de transparence pour les prêteurs
Pour les rachats de crédits immobiliers ou professionnels, le fichier positif offrirait des garanties supplémentaires aux établissements prêteurs. En connaissant
des risques et l’équilibre entre transparence et respect de la vie privée.
Un outil de prévention éprouvé ailleurs.
En Belgique, le fichier positif est géré par la Banque Nationale. Lorsqu’une personne souhaite contracter un crédit, les prêteurs sont tenus de consulter cette base de données avant d’émettre une décision. Elle contient des informations détaillées sur tous les crédits en cours, qu’il s’agisse de prêts hypothécaires, de
- Atteinte à la vie privée : En enregistrant systématiquement tous les crédits d’un individu, le fichier positif pourrait être perçu comme intrusif.
- Stigmatisation des emprunteurs : La transparence totale sur les engagements financiers pourrait dissuader certains prêteurs d’accorder des crédits, même à des profils solvables.
- Coût de mise en œuvre : Créer une base de données centralisée, sécurisée et accessible à tous les prêteurs représenterait un investissement considérable.
Cependant, les partisans du fichier positif rétorquent que la transparence est la clé d’une économie du crédit responsable. Selon eux, le système actuel encourage les situations de “surendettement invisible”, où les dettes se multiplient avant qu’un défaut de paiement n’apparaisse, souvent trop tard pour y remédier efficacement.
On peut aussi supposer que certains économistes ont mis en garde le gouvernement contre une telle mesure qui aurait un impact sur l’économie. Nous savons que des gens empruntent au-delà de leurs capacités de financement, mais cela se traduit en achats, et donc en TVA et consommation. Au lieu de cela, le législateur a mis en place une mention pédagogique “un crédit vous engage (…)” tandis que les banques se sont mises à faire du “crédit responsable”.
Jérôme CUSANNO
Directeur de l’IEPB