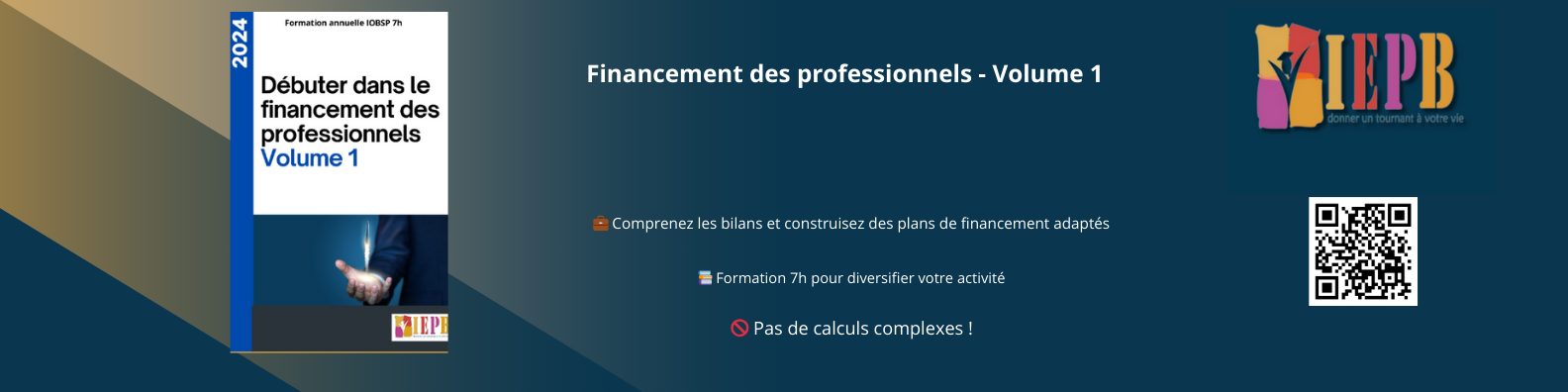Qui aurait cru que des bulletins de salaire et des relevés bancaires pourraient devenir les stars de la fraude ? Les crédits à la consommation sont les nouveaux terrains de jeu des faussaires, et les IOBSP se retrouvent au cœur de cette tempête.
Truquer ses documents pour obtenir un crédit. En 2022, la fraude documentaire dans le crédit à la consommation a explosé avec une augmentation de 79 % ! Résultat ? Plus de 585 millions d’euros de pertes. Et les documents falsifiés se multiplient : bulletins de salaire gonflés, fausses pièces d’identité, relevés bancaires bricolés… Internet est devenu une véritable place de marché pour acheter un “faux dossier” à des prix défiant toute concurrence.
Si les banques apparaissent souvent comme le premier rempart face à cette menace, ce sont bien les IOBSP qui se retrouvent en première ligne et les raisons sont multiples.
Pourquoi les IOBSP sont-ils les plus exposés ?
Les éléments qui expliquent pourquoi les IOBSP se trouvent particulièrement vulnérables face aux tentatives de fraude sont la spécialisation, la proximité et les ressources.
En effet, les IOBSP sont exposés de par les documents et justificatifs demandés pour exercer leur mission de recherche de solution de financement, un domaine où les tentatives de fraude sont fréquentes. En outre, leur relation de proximité avec les clients, favorise un climat de confiance, les rendant ainsi plus enclins à accepter les documents fournis sans vérification exhaustive.
De plus, contrairement aux grandes banques, les IOBSP disposent de moyens plus réduits pour mettre en place des systèmes avancés de détection de fraude, comme des logiciels contrôlés de comparaison de documents ou des bases de données limitées de documents falsifiés.
Ceci dit, bien que leur manque de ressources soit un facteur d’exposition, ils ne peuvent s’en dédouaner totalement.
Leur spécialisation pourrait les pousser à jouer un rôle plus proactif, notamment en adoptant des pratiques de vérification renforcées malgré les contraintes. Par exemple, vérifier l’orthographe dans les documents présentés par le client. Les logiciels qui établissent les fiches de salaires ne font pas de fautes. Il en est de même pour les relevés de compte ainsi que les avis d’imposition. On peut également vérifier les coordonnées de l’employeur et voir si l’entreprise existe ou est toujours en activité. Zoomer sur un relevé bancaire peut révéler des imperfections de pixels, révélatrices de montages graphiques.
Des répercussions à tous les niveaux
Les effets de la fraude documentaire touchent l’ensemble des acteurs impliqués.
Pour l’emprunteur, les risques sont graves. Si la fraude est découverte, ils peuvent être inscrits au Fichier des Incidents de Paiement (FICP), limitant leur accès aux crédits futurs, auquel s’ajoutent des poursuites pour faux et usage de faux également possibles.
Pour les IOBSP, les conséquences sont aussi financières que réputationnelles. Une affaire de fraude tache leur crédibilité auprès des banques partenaires, et peut entraîner des poursuites pour négligence si la fraude avait pu être évitée.
Les conséquences lourdes de la fraude documentaire montrent qu’il s’agit d’une problématique où la responsabilité doit être partagée.
Autant les IOBSP que les banques doivent renforcer leurs contrôles pour éviter que ce type de situation ne devienne trop fréquente.
La collaboration entre les acteurs : Une réponse coordonnée.
Face à la montée des fraudes, la collaboration entre les IOBSP, les banques et l’ACPR est plus cruciale que jamais. Ce partenariat, encouragé par les autorités de tutelle, repose sur plusieurs initiatives. Tout d’abord, l’échange d’informations, notamment. Les IOBSP signalent tout cas suspect à l’ACPR et aux établissements de crédit, notamment en lien avec des soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme et en retour, les banques et autorités partagent avec les IOBSP des informations sur les dernières tendances de fraude et les profils de fraudeurs.
Ensuite, des groupes de travail et formation sont mis en place : L’ACPR et les banques organisent régulièrement des groupes de travail avec les IOBSP pour échanger sur les bonnes pratiques. Par ailleurs, des formations sont proposées aux IOBSP pour les sensibiliser aux risques de fraude et leur apprendre à détecter les signes de fraude.
Enfin, le développement d’outils communs : ensemble, les banques et les IOBSP travaillent à développer des technologies de détection de fraude, comme des bases de données partagées de documents falsifiés ou des logiciels de comparaison de signatures.
La collaboration accumulée entre les acteurs, particulièrement en termes de partage d’informations, est une avancée importante.
Cependant, le défi reste de maintenir cette synergie dans le temps et de s’assurer que les petits acteurs du secteur ont accès aux mêmes ressources de formation et d’outils technologiques que les gros IOBSP.
Au-delà de la collaboration, certaines mesures pourraient être renforcées pour prévenir davantage les tentatives de fraude documentaire comme la standardisation des pratiques en uniformisant les processus de contrôle au sein des différents acteurs permettant de créer une chaîne de vérification plus cohérente ;
On peut envisager la sensibilisation, la formation continue et l’investissement dans la technologie comme solution. Il s’agit d’encourager l’accès aux outils avancés de détection, comme l’OCR et l’intelligence artificielle, pour tous les acteurs, y compris les petits IOBSP. Un soutien financier ou une mutualisation de ces outils pourrait permettre une sécurité accrue.
Ces propositions pourraient transformer la gestion de la fraude en crédit à la consommation.
Toutefois, leur mise en œuvre nécessite un engagement financier et humain important. La question reste de savoir si tous les acteurs – en particulier les IOBSP – pourront se doter de moyens suffisants pour lutter efficacement contre ce fléau.
En définitive, la fraude documentaire dans le crédit à la consommation reste une menace majeure pour la sécurité du secteur financier.
La collaboration entre IOBSP, banques et ACPR montre qu’il est possible d’organiser une défense concertée et efficace. Mais la route est encore longue : renforcer les contrôles, investir dans les technologies de détection et harmoniser les pratiques restent des chantiers essentiels.
En fin de compte, alors que le secteur continue d’évoluer vers la digitalisation, les acteurs du crédit seront-ils prêts à aller encore plus loin pour protéger la confiance des consommateurs dans un monde financier toujours plus complexe ?
On finira bien par le savoir.
Charles-Hubert MEYERGUE Juriste à l’IEPB